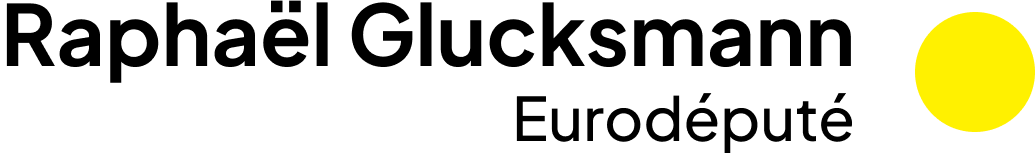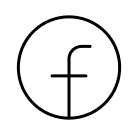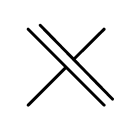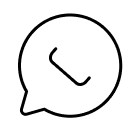Vive l’Affiche Rouge !
Françaises, Français, mes chers compatriotes,
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec l’Histoire.
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec l’autre et avec nous-mêmes, avec cet autre qui nous permet d’être véritablement nous-mêmes,
Aujourd’hui, les métèques, les apatrides, les gamins des faubourgs, les mômes des classes dangereuses prennent place au cœur et au sommet de la Patrie,
Aujourd’hui, Gavroche entre au Panthéon, un Gavroche au sang mêlé et aux papiers douteux, un Gavroche juif, arménien, espagnol, italien, et pourtant français, absolument, indubitablement français, français comme vous et moi, et bien plus encore,
Aujourd’hui, les bien nés, les bien logés, les bien rangés s’inclinent devant les mal rangés, les mal logés, les mal nés,
Aujourd’hui, la nation se prosterne devant ces femmes et ces hommes venus d’ailleurs qui ont nourri notre terre et notre âme de leur génie et de leur sang, ces hommes et ces femmes qui ont fait notre Histoire, qui nous ont faits, nous tous qui sommes ici.
Aujourd’hui, en les retrouvant, la France se retrouve elle-même, en les honorant, nous nous honorons nous-mêmes.
Écoutez, chers compatriotes, la voix du poète qui chanta la France mieux qu’aucun autre dans la nuit de l’Occupation, écoutez la voix de Louis Aragon :
« Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. »
Ils étaient vingt-trois, dont beaucoup avaient fui très tôt dans l’existence la haine, les persécutions et, pour deux d’entre eux, un génocide déjà.
Vingt-trois qui avaient épousé la France, à la vie et à la mort, dans la vie et dans la mort.
Vingt-trois dont certains n’avaient pas encore 20 ans et quasi tous pas encore 30.
« Nous sommes des enfants les uns et les autres », rappelle l’un d’eux, Zalnikov, ouvrier fourreur de 19 ans, dans sa lettre d’adieu.
Vingt-trois mômes au sang impur et au cœur saint qui prirent les armes pour défendre notre nation quand tant d’adultes, français de souche et de papiers, la livraient pieds et poings liés aux occupants.
Vingt-trois « terroristes apatrides » – c’est ainsi qu’on les désignait – qui furent arrêtés par la brigade spéciale des Renseignements généraux de notre État. Arrêtés, puis livrés par des Français : j’insiste sur ces mots, la douleur qu’ils suscitent, la honte qu’ils génèrent.
Vingt-trois destins immenses, tragiques et une question qui m’habite depuis l’adolescence, depuis que ces vers d’Aragon résonnent en moi, depuis que je réfléchis à ce qu’être français veut dire : qui de ces métèques, de ces Juifs de l’Est, de ces Arméniens, de ces Italiens qui donnèrent leur vie pour la patrie ou de ceux qui la trahirent en les livrant à l’ennemi, qui étaient les plus français ?
Cette question, j’aimerais que nous nous la posions tous, maintenant, alors que pointent à nouveau, une fois de plus, les tentations du repli et du rejet.
Elle nous interroge sur ce que notre nation a de singulier et d’universel, sur notre destin commun et notre identité collective.
Elle définit un certain rapport au monde et à la France, un rapport au monde qui fait la France, notre France.
Que les gardiens du temple se rassurent : je n’entends pas aujourd’hui m’adonner à cette repentance qu’il est convenu d’agonir sans jamais penser qu’un regard critique sur soi permet de mieux se connaître et donc de mieux s’aimer, sans songer qu’une nation forte, sûre de ses principes et de ses idéaux, n’a pas peur de se confronter aux zones d’ombre de son passé.
Non, je veux au contraire célébrer, ici et maintenant, cette part universellement, éternellement glorieuse de nous-mêmes.
Mais pour la célébrer, nous avons besoin de nous confronter à cette question :
Qui du Juif polonais ou hongrois, de l’Italien, de l’Espagnol, de l’Arménien luttant contre l’occupant ou du fonctionnaire qui les arrête pour plaire à l’ennemi, qui est le plus digne d’être par nous appelé « Français » ?
Si l’on a quelque estime de soi, si l’on aime la France, si l’on connaît son histoire, la réponse est évidente, immédiate.
Elle est lourde de sens pourtant, et je veux que nous en saisissions bien toutes les implications.
Elle nous dit quelque chose d’essentiel sur nous, quelque chose de consubstantiel à notre être, à notre identité, quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd’hui.
Elle nous dit que la France, notre France est infiniment plus qu’une affaire de sang ou de généalogie, infiniment plus qu’une affaire de papiers ou de bureaucratie, infiniment plus qu’une affaire de patronyme ou de religion.
Elle nous parle de cosmopolitisme, d’universalisme, de droits de l’homme, de tous ces mots que nous n’utilisons plus par peur ou par paresse et que j’entends réhabiliter devant vous, avec eux (il montre du doigt les cercueils). Ici et maintenant.
Elle nous parle de ces mots qui ont fait notre histoire avant que notre indolence politique et notre lâcheté intellectuelle ne les vident de leur sens.
Elle évoque cette « certaine idée de la France » qui fut selon de Gaulle le ferment du « pacte vingt fois séculier entre la liberté du monde et la grandeur de la France ».
Elle intime aux tenants du droit du sang qui, depuis de longues années, parlent si haut et si fort de se taire un instant et d’écouter la voix de notre nation sortir de ces cercueils, d’entendre le chant français qui jaillit des tombeaux que voici.
Elle exige des apôtres du repli une trêve dans leurs diatribes contre les migrants, les manants, les mendiants, une pause dans leur haine des réfugiés qui meurent dans nos mers ou errent sur nos terres.
Cette réponse, mes chers compatriotes, nous dit que notre nation est un esprit, une histoire, un récit qui embrassent, accueillent, intègrent celui qui désire les porter, les continuer, les défendre et qui rejettent celui qui les trahit, les ignore, les avilit, quels que soient son nom de famille, son lieu de naissance, sa religion, son origine sociale.
Ce sont cet esprit libre, cette histoire humaniste, ce récit cosmopolite que nous honorons – que nous retrouvons – en accueillant au Panthéon Olga Bancic, Missak Manouchian, Marcel Rajman.
Trois enfants échappés des confins orientaux de notre continent, de la nuit des pogroms et des massacres.
Trois Français de cœur et d’âme sinon de sang et de papier.
Trois étrangers et pourtant trois Français paroxystiques.
Trois, et à travers trois, tous les « Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant ».
« Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles », l’ennemi « Y cherchait un effet de peur sur les passants », nous rappelle Aragon.
Vingt-trois noms d’autant plus importants à énoncer qu’ils sont difficiles à dire.
Les voici :
Olga Bancic, 32 ans
Celestino Alfonso, 27 ans. Il écrit dans sa lettre d’adieu, lui le républicain espagnol tout juste arrivé sur notre terre et prêt déjà à l’arroser de son sang : « Je ne suis qu’un soldat qui meurt pour la France… »
Joseph Boczov, 38 ans
Georges Cloarec, 20 ans
Rino Della Negra, 19 ans
Thomas Elek, 18 ans
Maurice Fingercwajg, 19 ans
Spartaco Fontano, 22 ans
Jonas Geduldig, 26 ans
Emeric Glasz, 42 ans
Szlama Grzywacz, 34 ans
Amedeo Usseglio, 32 ans
Léon Goldberg, fusillé le jour de ses 19 ans. Il écrit quelques heures avant de mourir à son amoureuse : « Je n’ai pas peur de mourir. Je trouve quand même que c’est un peu tôt. Comme cadeau d’anniversaire, c’est réussi n’est-ce pas ? Vive la France ! »
À ses parents, qui furent gazés à Auschwitz, il dit : « Si vous revenez, ne me pleurez pas, j’ai fait mon devoir en luttant tant que j’ai pu… Vive la France. »
« Vive la France ! » : Léon Goldberg, Juif polonais arrêté par des Français dont les parents furent raflés par des Français eux aussi, meurt donc en disant, en pensant, en criant « Vive la France ! ».
Quelle leçon pour ceux qui aujourd’hui crient « Nique la France ! ».
Quelle leçon pour ceux qui aujourd’hui beuglent « les étrangers dehors ! ».
Et quelle leçon pour nous tous qui assistons sans mot dire à la débâcle de l’idéal cosmopolite français !
Souvenons-nous de Léon Goldberg et de ses derniers mots. J’y reviendrai.
Stanislas Kubacki, 36 ans
Cesare Luccarini, 22 ans
Missak Manouchian, 37 ans
Armenak Arpen Manoukian, 44 ans
Marcel Rajman, 21 ans
Roger Rouxel, 18 ans qui signe ainsi ses adieux à sa fiancée : « Ton petit ami qui te quitte pour toujours. »
Antoine Salvadori, 24 ans
Willy Schapiro, 29 ans
Wolf Wajsbrot, 18 ans
Robert Witchitz, 19 ans
À travers trois, vingt-trois. »
Et à travers vingt-trois, des centaines, des milliers : tous les étrangers, les métèques, les allogènes noyés dans les brumes de l’oubli qui combattirent pour notre liberté et qui moururent pour que nous puissions vivre.
Je pense à ce prince géorgien déchu devenu le roi incontesté de la Légion étrangère, Dimitri Amilakvari dont l’histoire me fut contée avec émotion par de jeunes légionnaires il n’y a pas vingt jours de cela. Je leur avais promis de la raconter, la voici.
Au moment de la débâcle de 1940, cet officier que les Anglais considèrent comme le plus grand héros militaire français de la guerre déclara : « Je dois tout à la France et ce n’est pas au moment où elle a besoin de moi que je l’abandonnerai. » Il conduisit – fait unique – l’ensemble des hommes sous son commandement à Londres, sans demander l’avis de personne, formant à lui seul le noyau dur des Forces françaises libres. « On ne refuse rien à un homme comme Dimitri » est une phrase qu’on répète encore dans les rangs de la Légion.
Sa conduite fut si brave à Bir Hakeim que le général Kœnig dit qu’il effraya les colonnes de tanks allemands à lui seul. Lorsque de Gaulle lui remit la croix de la Libération, le 10 août 1942, il eut ces mots glaçants et admirables : « Nous, étrangers, n’avons qu’une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l’accueil qu’elle nous a réservé : nous faire tuer pour elle. » Quelques mois plus tard, il se sacrifia pour permettre le triomphe des troupes alliées à El-Alamein. Il repose aujourd’hui quelque part dans les sables d’Égypte. Sa tombe, perdue dans le désert, est frappée de l’inscription suivante « Est mort pour que la France vive. »
Songe, peuple de France : était-il plus ou moins français, ce géant des montagnes du Caucase que la cohorte des petits hommes qui, ayant reçu une carte d’identité en cadeau à la naissance, étaient prêts pour sauver leur peau à vendre celle de leur patrie ?
« Morts pour que la France vive » : c’est l’épitaphe de tous ces Russes blancs et ces Juifs rouges des FFL, ces républicains espagnols de la Nueve qui libérèrent l’hôtel de ville de Paris avant de rendre Strasbourg à la France, de tous ces Italiens antifascistes qui furent accueillis si froidement et aimèrent notre pays avec tant de feu, de tous les humanistes apatrides, les expulsés, les exclus qui, comme Dimitri, comme vous trois qui entrez ici, ont choisi la France que nous avons reçu en héritage et l’ont aimée tellement plus que tant de rentiers de la nation pour qui elle était aussi naturelle que l’air qu’on respire.
« Morts pour que la France vive » : c’est aussi l’épitaphe des tirailleurs sénégalais qui prirent d’assaut le fort de Douaumont les 24 et 25 octobre 1916 à Verdun. Ils s’élancèrent en première ligne, prirent les mitrailleuses allemandes, combattirent au corps à corps, au coupe-coupe et à coups de crosse. Les Allemands reculèrent. Sous les vivats des autres soldats français, les Sénégalais prirent Douaumont. Des milliers d’entre eux ne revirent jamais leur terre, pour toujours prisonniers de la boue de Verdun.
« Morts pour que la France vive » : cette épitaphe qui rend français parmi les Français, c’est la vôtre, chère Olga, cher Missak, cher Marcel, chers vingt-trois.
Dans la nuit qui engloutit vos pères, vos mères, vos épouses, vos enfants, vos frères et vos sœurs, vous avez mené un combat implacable, pour eux, pour nous.
Mal armés, mal nourris, toujours en fuite, sans cesse traqués, vous avez harcelé dans les rues de Paris et de sa banlieue les forces d’occupation.
Attaques de convois de troupes, de casernes, de détachements d’artilleurs, de parades d’officiers de la Kriegsmarine, exécutions de miliciens, de délateurs, de hauts gradés : Thielbein trésorier de l’armée allemande, le général Von Apt, le « docteur » Julius Ritter responsable du Service du travail obligatoire, le sinistre STO…
Et encore, déraillements des trains militaires sur les lignes Paris-Troyes, Paris-Reims, Paris-Montargis, Paris-Verdun… »
Et encore, opérations surprises contre les uniformes gris vert vautrés aux terrasses des cafés et servis par tant des nôtres sans honte ni vergogne.
Toujours à trois, en triangle, un tireur, deux défenseurs non armés faute de munitions, vous vous postiez au plus près de la cible pour mieux l’identifier, ne pas la rater, ne pas tuer d’innocents.
Le péril était plus grand ainsi et nombre de vos compagnons périrent en cours d’opération. Mais vous assassiniez sans être des assassins. Un résistant écrit de vous : « Ce n’est pas de gaîté de cœur qu’ils passent à l’acte. Ils ne sont ni des tueurs ni des héros de cinéma à la gâchette facile. Ce sont de simples jeunes qui respectent la vie, ne trouvent pas facilement le sommeil et sont en proie à de violents cauchemars. »
Vous étiez les plus soutiers de ces « soutiers de la gloire », pour reprendre les mots de Pierre Brossolette sur la BBC : « un régiment sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s’inscriront point en lettres d’or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront ».
Vous apparteniez aux FTP-MOI, ces « Francs-tireurs et partisans de la main-d’œuvre immigrée » qui furent parmi les premiers à relever notre drapeau en berne.
Depuis le 2 mars 1943, vous formiez la 1re section de l’Armée secrète, sur décision de Jean Moulin.
Vous n’avez pas traîné : entre le 17 mars et le 12 novembre 1943, plus d’une centaine d’actions accomplies à Paris pour le compte de la France combattante.
Écoutons Charles Tillon, le commandant en chef des Francs-tireurs et partisans, parler de vous avec admiration :
« On ne dira jamais assez ce que la résistance armée doit à ces travailleurs manuels et intellectuels qui formaient ce qu’on appelait la MOI en 1939. Dès les premiers jours de l’Occupation, ils furent volontaires pour défier la mort, eux qu’on appelait les “étrangers” se sentaient dans le cœur l’amour du pays qui les avait repoussés, l’amour du pays qui les avait reçus. »
Une part de France vous rejetait, notre part honteuse, une autre vous admirait, la part fière, la part qu’il nous incombe à tous de continuer et défendre.
Votre procès, dit « procès des étrangers », s’ouvre le 17 février 1944.
Il est exactement 9 heures du matin lorsque vous faites votre apparition dans les salons lambrissés de l’hôtel Continental reconvertis en cour martiale allemande. La salle est drapée de rouge et de noir, aux couleurs du drapeau nazi. Trois « juges » militaires allemands, un procureur militaire allemand, un interprète militaire allemand, la presse, la radio, les caméras allemandes, mais aussi les caméras françaises vous font face.
On décrit longuement dans la presse aux ordres des « gueules de criminels à la solde de Londres et de Moscou », des « gueules d’anti-France ».
L’occupant et ses relais veulent faire de vous des incarnations de la « pègre internationale » : « leurs têtes hideuses. Le sadisme juif s’y étale dans l’œil torve, les oreilles en chou-fleur, les lèvres épaisses et tombantes, la chevelure crépue et filasse. Crasse physique et tare mentale : voilà l’armée du crime », ces lignes abjectes sont tirées d’un journal français – oui, français – dont le nom est heureusement tombé dans l’oubli et que je ne citerai pas pour ne pas lui redonner vie.
Le simulacre commence. Il dure quatre jours. Le verdict tombe le 21 au matin, sans surprise : pour tous, la mort.
À 15 heures, vous êtes fusillés.
Les services de propagande nazis ont concocté une affiche tirée à 15 000 exemplaires qu’ils collent le même jour sur les murs de toutes les grandes villes de France.
Hauteur : 1 m 52, largeur : 1 m 30. Rouge, couleur de sang. Dix médaillons forment un triangle agressif, dix têtes de forçats. En bandeau, vos noms « difficiles à prononcer » : Wajsbrot, Grzywacz, Fingercwajg, Boczov, Manouchian…
Six photos attestent de vos « crimes » et une question barre la page : « Des Libérateurs ? ». La réponse cingle : « La libération par l’armée du crime ! ».
Dans Paris, des dizaines de milliers de tracts sont distribués. Au recto de ceux-ci, une réduction de l’affiche et au verso, le commentaire suivant : « Voici la preuve/ Si des Français pillent, volent et tuent/ Ce sont toujours les étrangers qui les commandent/ Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent/ Ce sont toujours des juifs qui les inspirent/ C’est l’armée du crime contre la France/ C’est le complot de l’anti-France ! »
Face à vos visages censés effrayer le chaland et si beaux en réalité, deux France se révèlent. Deux France irréconciliables.
L’une, trop heureuse d’éviter la vindicte de l’occupant, détourne le regard ou, pire, se réjouit de votre supplice.
L’autre vous regarde dans les yeux, émue. Elle vous contemple et vous aime. Elle se reconnaît en vous, s’identifie à vous.
Laquelle est l’anti-France ? Laquelle est la France ? »
Certains passants, la nuit venue, déposent une fleur devant l’Affiche, d’autres griffonnent « morts pour la France », « martyrs », « armée de la résistance ».
Simone de Beauvoir raconte : « Tous ces visages qu’on proposait à notre haine étaient émouvants et même beaux ; je les regardai longtemps sous les voûtes du métro, pensant avec tristesse que je les oublierai. »
Elle ne vous a pas oubliés. Nous ne vous avons pas oubliés. Et nous ne vous oublierons jamais.
Vos beaux visages forment le grand et beau visage de la France libre, la seule qui vaille à nos yeux.
Vos visages, chers vingt-trois, forment le visage de la France que je sers, que j’aime, que je préside.
Nous sommes le 21 février 1944 au matin. Vous êtes condamnés.
Au moment d’entrer dans le fourgon, l’un d’entre vous sourit et l’autre tire la langue aux caméras.
Jean Cassou, résistant poète, poète entré en résistance, écrit de vous : « Méprisants ? Non. Mais ironiques, et fatidiques. Légers. Réduits à leur seule liberté. » Réduits à la part essentielle de l’homme : sa liberté.
Nous sommes le 21 février 1944 à 15 heures, au mont Valérien.
Face au peloton d’exécution, ceux d’entre vous qui ne sont pas ligotés lèvent le poing. D’autres, ou les mêmes, chantent ou sifflotent L’Internationale et La Marseillaise.
Vous avez tous décliné le bandeau pour défier du regard les fusils et les bourreaux.
« Ils refusaient les yeux ouverts ce que d’autres acceptent les yeux fermés », écrit René Char.
Nous sommes le 21 février 1944 et vous êtes vingt-deux à tomber sous les balles.
Vingt-deux car le vingt-troisième est une femme. Les nazis ne fusillent pas les femmes, ils leur coupent la tête. Le paragraphe 103 de l’article 3 de leur règlement est clair : « l’exécution des hommes se fait par fusillade, les femmes doivent être décapitées ». Pas en France, en Allemagne. Alors que vous mourez ensemble, Olga Bancic est transférée vers Stuttgart. Elle sera guillotinée au 18 Urbanstrasse, à 5 heures du matin, le 10 mai 1944. Le jour de ses 32 ans. Seule, en territoire ennemi.
Olga est née en Bessarabie. Jeune syndicaliste, elle est emprisonnée et battue à plusieurs reprises par la « Sûreté » de l’État roumain.
Elle se réfugie à Paris en 1939 et donne naissance à Dolores, française grâce à ce droit du sol et que – j’en fais ici le serment solennel – je défendrai jusqu’à mon dernier souffle.
Quand les tanks allemands submergent nos défenses et déferlent sur notre pays, Olga cache sa fillette dans une famille française, l’une de ces familles de Justes qui furent l’honneur de notre nation quand l’État en fut la honte.
Elle s’engage dans la MOI, rejoint le groupe Manouchian et participe à une centaine de combats. Son nom de guerre est Pierrette.
« Pierrette était chargée du transport des armes. Elle devait à l’heure dite apporter des grenades et des revolvers, puis les récupérer après l’action. Après le bouleversement d’un attentat, le quartier était tout de suite encerclé, les maisons fouillées et les rames de métro arrêtées. Les hommes qui avaient tiré s’enfuyaient immédiatement à vélo, mais Olga qui avait attendu que les combattants aient fini leur travail ne bougeait pas et elle récupérait les armes (nous en avions très peu) », témoigne un de ses copains, survivant, Arsène Tchakarian.
Le 9 mai 1944, Olga parvient à jeter par la fenêtre une lettre adressée à la Croix-Rouge et destinée à sa fille de quatre ans.
« Chère Madame, je vous prie de remettre cette lettre à ma petite fille Dolores Jacob après la guerre. C’est le dernier désir d’une mère qui va vivre encore 12 heures. Merci. »
« Ma chère petite fille, mon cher petit amour,
Ta mère écrit la dernière lettre, ma chère petite fille, demain à 6 heures, le 10 mai, je ne serai plus.
Mon amour, ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Tu n’auras plus à souffrir. Sois fière de ta mère, mon petit amour. J’ai toujours ton image devant moi.
Je vais croire que tu verras ton père, j’ai l’espérance que lui aura un autre sort. Dis lui que j’ai toujours « pensé à lui comme à toi. Je vous aime de tout mon cœur. »
Olga n’a pas parlé sous la torture et n’a pas connu « la chance de mourir ensemble ».
Peuple de France, souviens-toi d’Olga Bancic, morte pour un pays dans lequel elle n’avait connu qu’une année de paix et de liberté, dont elle ne connaissait que l’histoire glorieuse et le présent sinistre.
Chère Olga Bancic, entre ici, dans le cœur d’une nation dont tu fus l’âme lumineuse et le visage solaire au moment où une nuit éternelle menaçait de l’envelopper.
Le 21 février 1944, Marcel Rajman meurt à 21 ans.
Marcel, c’est la grande littérature française revisitée. Un Gavroche des faubourgs qui se mue en Julien Sorel face à ses juges lorsqu’il proclame crânement : « Je rappelle au tribunal mon impossibilité de vivre sans lutter contre la force armée allemande ! »
Les tracts de l’occupant lui taillent la place d’ennemi no 1 : « Rajman le tueur, assassin de dix-sept Français, déclarant avec cynisme à l’instruction qu’il voudrait voir toutes les rues pavées de têtes de femmes et d’enfants goys ».
Plus cultivé et tout aussi ignoble un journaliste de la presse aux ordres écrit : « Rajman semble échappé d’un roman russe. Échevelé, pâle jusqu’aux lèvres, l’œil opalin, il n’est pas de notre temps. C’est le nihiliste d’autrefois, le révolté de toujours, l’éternel dérailleur de train. »
Non, Marcel n’est pas une figure de littérature étrangère : il est le roman français dans toute sa splendeur. »
Né à Varsovie dans une famille juive, il a 8 ans quand ses parents se réfugient en France et s’installent 1 rue des Immeubles-Industriels, au cœur de ce 11e arrondissement si populaire et si cosmopolite. À l’école, il rattrape brillamment son retard. Faute d’argent, à douze ans il est livreur, à quinze ouvrier tricoteur.
Plus parigot que les parigots, belle gueule, cheveux en bataille, des yeux verts, de grosses joues enfantines, toujours le mot pour rire et le sourire aux lèvres : Marcel est le roi du quartier. Il danse et il boit chez « Bouboule », il va à la piscine avec ses potes, il incarne la figure si attachante, si française du Titi parisien.
Le 21 août 1941, il assiste place de la Nation à l’arrestation de son père, qui ne reviendra pas des camps. Il adhère alors aux jeunesses communistes, échappe aux incessantes rafles de juifs, entre en clandestinité, collectionne les pseudonymes « Léo », « Faculté », « Tchapaiev », « Michel », « Simon »… Avant d’opter pour « Marcel Rougemont ».
En 1942, il intègre le détachement juif des FTP, puis l’Armée secrète. Désormais il a un matricule comme dans une armée régulière. Son numéro : le 10305. Les combattants de son groupe ne sont qu’une centaine, mais tous leurs matricules commencent par 10 000 afin d’impressionner l’ennemi.
Son premier fait d’arme a lieu le 3 juin 1942, 17 rue Mirabeau, dans le 16e arrondissement de Paris. Avec un copain, Ernest Blankopf, ils lancent des grenades bricolées sur un car de la Kriegsmarine. Sous le feu nourri des Allemands, il parvient à s’échapper. Ernest, lui, est grièvement blessé. Pour éviter d’être pris, il se tire une balle dans la tête.
Marcel s’impose vite en maître de guerre urbaine. À vingt ans, stratège brillant, il passe instructeur et c’est sous ses ordres que Manouchian mène sa première action à Levallois-Perret.
Marcel dirige la « section spéciale » dite « Stalingrad », celle des coups les plus durs et les plus périlleux, il se paie les cibles les plus prestigieuses.
« Le 28 septembre 1943, à 9 heures du matin, dans la rue Pétrarque à Paris, trois partisans armés de pistolets ont abattu dans sa voiture le docteur Ritter, représentant en France de Fritz Sauckel, commissaire à la main-d’œuvre, chargé de la déportation en Allemagne des travailleurs des pays occupés… »
Cet attentat, l’un des faits d’armes les plus retentissants de la résistance, ébranle l’occupant. Comme tant d’autres, il porte la signature de Marcel. Son ami Alfonso tire le premier ; les balles sont amorties par les vitres de la voiture, mais l’ennemi est blessé : il tente de sortir du véhicule par la porte opposée et se trouve nez à nez avec Marcel qui l’achève de trois balles.
Après plus de 150 actions en deux ans, il est pris en même temps que les autres.
Derniers instants. Derniers mots. À sa mère, Chana, déjà gazée à Auschwitz (convoi 67) – mais il ne le sait pas – il écrit :
« Ma chère petite Maman, quand tu liras cette lettre, je suis sûr qu’elle te fera une peine extrême, mais je serai mort depuis un certain temps… Excuse-moi de ne pas t’écrire plus longtemps, mais nous sommes tous tellement joyeux (…). J’aurais voulu vivre rien que pour toi… Ton Marcel qui t’adore et qui pensera à toi à la dernière minute. Je t’adore et vive la vie ! »
« Vive la vie ! » En préparant ce discours, les larmes me sont venues en lisant ces derniers mots d’un condamné à mort de 20 ans.
À son petit frère Simon, déporté à Buchenwald (convoi 85), mais il ne le sait pas non plus, il écrit :
« Vive la vie belle et joyeuse comme vous l’aurez tous… ne fais pas attention si ma lettre est folle mais je ne peux pas rester sérieux. »
À sa tante :
« Je vais être fusillé aujourd’hui à 15 heures… Nous venons de recevoir un colis de la Croix-Rouge et nous mangeons comme des gosses toutes les choses sucrées que j’aime tant… Ici on est tous en joie. Je suis sûr que cela vous fera plus de peine qu’à nous. Marcel. »
Le garçon qui écrit ces lignes a été bestialement torturé. Il nous dit : « on est tous en joie » et « vive la vie » !
Jeunesse de France, souviens-toi de Marcel Rajman. Retrouve-toi en lui, gamin des faubourgs qui effraya l’occupant et prit place ici, soixante-dix ans plus tard, au cœur de la nation. Chez lui. »
Missak Manouchian est déjà rescapé d’un génocide quand l’autre commence : il est arménien.
« Comme un forçat supplicié, comme un esclave qu’on brime,
J’ai grandi nu sous le fouet de la gêne et de l’insulte,
Me battant contre la mort, vivre étant le seul problème…
Quel guetteur têtu je fus des lueurs et des mirages. »
L’homme qui a écrit ces vers est un poète avant d’être un soldat et un réfugié avant d’être un poète.
Quand en 1925 Missak débarque à Marseille avec son petit frère Karabet, il a déjà tout vécu. Tout vu. Tout connu. La guerre, les massacres, l’exode, la famine, les coups, la peur, l’orphelinat. »
À neuf ans, il assiste à l’assassinat de ses parents, de pauvres paysans d’Adryaman au bord de l’Euphrate, par les soldats turcs.
Dans sa fuite, il croise une famille kurde qui le cache et le protège. Recueilli, comme tant d’enfants arméniens dans un orphelinat de Djounié au Liban, passé sous contrôle français en 1918, il rêve de liberté, de révolution, de littérature. Il rêve de France.
Son itinéraire sera celui d’un errant, orphelin entouré par la mort et pourtant plein de vie : « et qu’on dise de moi : il est fou d’ivresse ». Ivre d’amour, d’idéal, de vie.
Tour à tour ouvrier tourneur chez Citroën, modèle pour sculpteurs, auditeur libre à la Sorbonne, il écrit des poèmes, « traduit Baudelaire, Verlaine et Rimbaud en arménien et les publie dans des revues.
Écœuré, le 6 février 1934, par les bandes fascistes qui déferlent dans les rues, il adhère au parti communiste.
En 1939, il s’engage dans l’armée française – contre les ordres d’un parti qui soutient alors le Pacte germano-soviétique – pour combattre l’agression allemande.
Après la défaite, il entre en résistance, puis rejoint les FTP-MOI en février 1943. Après avoir été entraîné à la guérilla urbaine par Marcel, Missak devient responsable du groupe.
Il aime ses jeunes et éphémères soldats de l’ombre qu’il appelle affectueusement « mes papillons ».
Le 16 novembre 1943, Manouchian est arrêté sur les berges de la Seine, à Evry. Il a été dénoncé.
Mont Valérien. Dernière lettre à sa femme Mélinée, sa « petite orpheline bien-aimée ». Il écrit :
« Je m’étais engagé dans l’Armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur et la liberté et la paix de demain… Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand… Bonheur à tous. »
Missak Manouchian figure sur l’Affiche rouge, plein centre, avec la mention « chef de bande ». Missak Manouchian est « mort pour que tu sois libre, cher peuple de France. Souviens-toi de Missak Manouchian.
Olga, Missak et Marcel, on vous nommait « les étrangers » ou les « apatrides ». Vous étiez, vous êtes, vous resterez toujours les plus français des Français. Français d’honneur, doublement français par le sol défendu et par le sang versé. Le sang et la terre dont on hérite ne disent rien comparés au sang qu’on verse et à la terre qu’on défend.
Écoutons aujourd’hui ce sang versé, cette terre sauvée nous parler. De vous, pour vous.
« Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur… », écrivait Aragon, le poète qui vous a le mieux chantés.
Rien n’est jamais acquis. Aujourd’hui, nous le voyons, nous le sentons.
Et c’est pour cela que nous avons besoin de vous, de vous entendre et de vous voir.
Aujourd’hui, alors que notre pays est frappé par les attentats sanglants d’une nouvelle Internationale totalitaire – l’Internationale djihadiste – ayant sur notre sol des soutiens et des complices, alors que notre société est ébranlée dans ses fondements, alors que notre foi dans nos idéaux démocratiques et universalistes est à nouveau testée, il est plus important que jamais de vous entendre et de vous voir.
Alors que les tentations du repli et du rejet progressent chaque jour, alors que j’entends à chaque heure des voix réclamer que l’on ferme les portes de notre continent et de notre pays aux centaines de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants qui s’abîment en Méditerranée en quête non pas d’un monde meilleur, mais d’un monde ayant simplement autre chose que la mort comme horizon, il est urgent de revenir vers vous, les témoins sublimes de ce que peut être la France lorsqu’elle est fidèle à elle-même.
Victor Hugo eut ces mots magnifiques sur le rôle, le sens de l’Histoire : « Il faut, pour la marche en avant du genre humain qu’il y ait sur les sommets, en permanence de fières leçons de courage. L’aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. »
Puisse votre lumière nous électriser tous, puisse votre exemple guider nos pas face aux nouvelles menaces, puissent vos leçons de courage nous aider à relever les défis de l’avenir.
Vous avez étonné la catastrophe, vous êtes notre éternelle aurore. Il n’y a pas de peuples sans héros, n’en déplaise aux déconstructeurs professionnels, et il n’y a pas de politique sans symboles, n’en déplaise aux poseurs cyniques.
Vous êtes nos héros et nos symboles, vous êtes le message que nous apportons au monde et qui nous fait vivre.
Notre nation est fondamentalement cosmopolite. Son Panthéon devait l’être aussi.
Vous êtes ici chez vous, Olga, Marcel, Missak.
Alors entrez dans votre dernière demeure.
Je laisse le mot de la fin à Manouchian lui-même : »
« Que le sommeil et la lassitude ne voilent point nos âmes !
À tout moment l’ennemi change de couleur et de forme,
Et nous jette sans arrêt dans sa gueule inassouvie. »
Nos âmes ne se voileront pas, nous ne baisserons pas la garde, nous ne fermerons pas les yeux, grâce à vous, Olga, Marcel, Missak.
Vous êtes la France.
Vive l’Affiche rouge ! Vive la République et vive la France !
Discours fictif écrit dans Notre France (Allary éditions, 2016) par Raphael Glucksmann